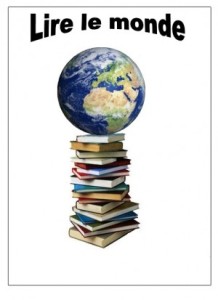À la rentrée des classes, Maxime alla au lycée Bonaparte. C’est le lycée du beau monde, celui que Saccard devait choisir pour son fils. L’enfant, si mou, si léger qu’il fût, avait alors une intelligence très vive ; mais il s’appliqua à tout autre chose qu’aux études classiques. Il fut cependant un élève correct, qui ne descendit jamais dans la bohème des cancres, et qui demeura parmi les petits messieurs convenables et bien mis dont on ne dit rien. Il ne lui resta de sa jeunesse qu’une véritable religion pour la toilette. Paris lui ouvrit les yeux, en fit un beau jeune homme, pincé dans ses vêtements, suivant les modes. Il était le Brummell de sa classe. Il s’y présentait comme dans un salon, chaussé finement, ganté juste, avec des cravates prodigieuses et des chapeaux ineffables. D’ailleurs, ils se trouvaient là une vingtaine, formant une aristocratie, s’offrant à la sortie des havanes dans des porte-cigares à fermoirs d’or, faisant porter leur paquet de livres par un domestique en livrée. Maxime avait déterminé son père à lui acheter un tilbury et un petit cheval noir qui faisaient l’admiration de ses camarades. Il conduisait lui-même, ayant sur le siège de derrière un valet de pied, les bras croisés, qui tenait sur ses genoux le cartable du collégien, un vrai portefeuille de ministre en chagrin marron. Et il fallait voir avec quelle légèreté, quelle science et quelle correction d’allures, il venait en dix minutes de la rue de Rivoli à la rue du Havre, arrêtait net son cheval devant la porte du lycée, jetait la bride au valet, en disant : « Jacques, à quatre heures et demie, n’est-ce pas ? » Les boutiquiers voisins étaient ravis de la bonne grâce de ce blondin qu’ils voyaient régulièrement deux fois par jour arriver et repartir dans sa voiture. Au retour, il reconduisait parfois un ami, qu’il mettait à sa porte. Les deux enfants fumaient, regardaient les femmes, éclaboussaient les passants, comme s’ils fussent revenus des courses. Petit monde étonnant, couvée de fats et d’imbéciles, qu’on peut voir chaque jour rue du Havre, correctement habillés, avec leurs vestons de gandins, jouer les hommes riches et blasés, tandis que la bohème du lycée, les vrais écoliers, arrivent, criant et se poussant, tapant le pavé avec leurs gros souliers, leurs livres pendus derrière le dos, au bout d’une courroie.
.
La curée – Emile Zola